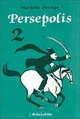Comme beaucoup de manga, XXth century boy fait référence à de nombreuses clés de l’histoire japonaise. Pour les français, il est très dur d’en comprendre le sens et la portée. Un petit décryptage s’imposait pour mieux cerner le vrai sujet de XX Century Boy. Alors que la série vient de se finir au Japon après 22 volumes
Par Stéphane
PORTRAIT : Naoki Urasawa est, avec Shuho Sato et Takéhiko Inoue (clin d’œil dans le volume 7), l’un des rares auteurs de manga de divertissement à mêler discours politique et philosophie humaniste, plutôt de gauche selon nos grilles de lecture française (si vous le désirez, télécharger le jolie petit abécédaire sur Urasawa publié dans le Chronicartde mai, coécrit par R. Brethes et moi, attention, il fait plus de 5mo).
THEME: XXth Century Boy parle, derrière son habit de polar, principalement du problème des Otaku (un phénomène de société japonais dont on discute beaucoup dans les médias de l’archipel, et dont le manga aime à parler par affinité). Le récit oppose de manière métaphorique les enfants devenus des otakus (la secte d’ami) à ceux qui ont su résister à ce mouvement de destruction social massif (la bande à Kenji). Le parcours de Kenji et ses amis sera d’apprendre à exploiter cette culture pour sauver le monde et fédérer l’homme, non l’isoler et le détruire comme le fait Ami.
1970 : Année clé de l’histoire japonaise, c’est l’univers dans lequel baigne l’enfant Kenji et ses amis dans les flash-back. Comme tous les dix ans depuis 1950, le Japon signe à nouveau dans la contestation populaire son accord avec les Etats-Unis d’amérique. Le peuple se soulève en partie, les universités font grèves, Kenji écrit le cahier des prédictions, l’incident nocturne dans l’école, qui provoquera bientôt la naissance d’Ami, a lieu. Mais surtout, c’est l’année de la première exposition universelle d’Asie ; Expo’70 (lien différent) sera ainsi pour une génération d’enfant le signal d’un futur différent, et reste à jamais le premier emblème de la culture Otaku à venir (la première génération d’otaku serait née dans les années 60 et se reconnaît à la visite de l’expo’70 enfant et à la découverte de La Tour du soleil (photo ci-contre)).
Tarō Okamoto : «Art is explosion» déclamait dans les années 80 le célébrissime artiste japonais Tarō Okamoto (1911-1996) dans une publicité télévisée pour les vidéocassettes Hitachi Maxwell. A l’époque, ce slogan fit de lui, du jour au lendemain, un emblème culturel majeur dans tout l’archipel. Pourtant, son travail créatif bénéficiait déjà d’une très forte reconnaissance grâce à La Tour du soleil, ce monument réalisé à l’occasion de la première exposition universelle d’Asie en 1970 à Osaka. Cette phrase, aux résonances profondes, met en avant le fait que la reconstruction d’une identité japonaise, après la défaite de la seconde Guerre Mondiale, est passée pour beaucoup par la création d’arts nouveaux. Le manga, et les cultures avoisinantes du dessin animé, jeu vidéo et quelques autres apparentées au monde de l’otaku, sont reconnues comme étant les formes les plus vives de cette manifestation. C’est pourquoi elles occupent une place centrale dans l’histoire du Japon moderne. Nombreux sont ceux qui pensent au pays du soleil levant que le manga est la première des conséquences de la défaite du Japon, de la domination américaine qui s’ensuivit, mais plus encore sont ceux qui voient dans le manga l’unique remède pour un pays et un peuple essayant de guérir du cauchemar insondable du bombardement atomique. Tarō Okamoto, en tant qu'emblême de la culture otaku, est ainsi au coeur de XXth Century Boy, que cela soit par le présence dans le récit de L'Expo' 70, de la Tour du Soleil, et plus encore pour le symbole de la secte d' Ami (voir la photo de Okamoto ci-contre, trés explicite)
AMI : est l’incarnation de l’otaku. Désincarné, il vit dans un monde de fantasmes liés à l’enfance et au dessin animé. Il rêve d’un New type (thème de la nouvelle humanité chèr au manga). Il n'est pas difficile de voir, dans la secte d'ami, une transposition fantasmatique de la secte Aum. Cette dernière se revendiquait en partie du boudhisme, mais aussi des cultures otaku. Elle reste cééèbre pour l'organisation de nombreux attentats, dont un très traumatisant au gaz sarin dans le métro Tokyoïte en 1995, qui fit une quinzaine de morts et plus de 5000 bléssés.
KENJI : l’anti Otaku. Il a quitté les rivages de l’enfance, oublié cette culture pour passer à l’age adulte. Il incarne l’anti-Otaku parce qu’il s’occupe de sa petite nièce (donc il tisse du lien social) et fonde à sa manière une famille. Il travaille aussi dans un convini familial, autre signe de résistance à la culture otaku qui, elle, se fédère fortement autour de la chaîne américaine Seven/Eleven.
YABUKI JOE : Pseudo de Kenji, tiré de la série Ashita no Jô (Le Joe de Demain) de Tetsuya Chiba, malheureusement non publiée en France pour le moment. Dans les années soixante, Joe est ce marginal solitaire et boxeur virtuose qui refuse le modèle de vie de son époque. La fin de cette décennie marque en effet l’ancrage de la société japonaise dans une prospérité économique faisant passer au second plan les plaies de la pollution industrielle ou d’une urbanisation ravageuse. Pour les japonais qui refusent d’abandonner leur passé tout comme pour ceux qui voit la tutelle américaine et ses dérives quotidiennes d’un bien mauvais œil, Joe se présente –et demeure aujourd’hui encore- dans nombres d’esprits le modèle parfait du antihéros. C’est pourquoi Kenji choisit ce nom.
L’un des plus célèbres évènements de l’histoire du manga reste la mort du boxeur Tôru Rikiishi, adversaire célèbre, relatée le 22 février 1970 (et oui toujours la même année) dans un épisode ultime concluant plusieurs semaines de combat acharné, au rythme de la parution du magazine qui prépubliait Ashita no Jo. Sous la pression des lecteurs atterrés, la maison d’édition Kôdansha se trouva contrainte d’organiser une cérémonie funéraire en l’honneur de ce héros virtuel. Ces huit rounds épiques avaient tenu en haleine la jeunesse de l’époque – en particulier ceux qui s’étaient engagés dans les mouvements étudiants militant contre le renouvellement du traité de sécurité qui lie Amérique et Japon, retrouvant dans le personnage de Joe un modèle de liberté. Fin février, la tension est à son comble. “Rikiishi est mort !” Au lycée Azabu, l’un des établissements les plus prestigieux de Tôkyô, ce cri est lancé à la cantonade, faisant se vider les salles de classe… pendant ce temps, kenji et sa bande construisent leur base secrète...