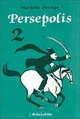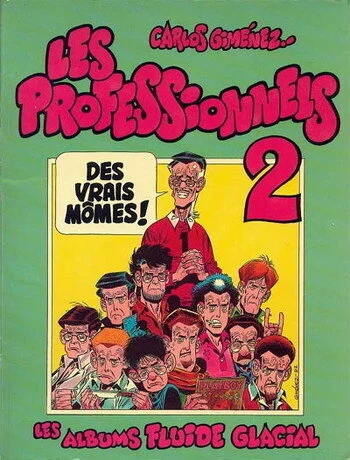« Je ne crois pas à cette thèse selon laquelle les femmes écrivent différemment des hommes », a dit Marjane Satrapi dans une interview donnée à Michel Edouard Leclerc.
Tout faux ai-je envie de dire à cette charmante artiste qui me semble dès lors n’avoir qu’une vue limitée sur sa propre création. Comme tous les artistes en fait. En effet, Persépolis fait montre de toutes les caractéristiques de l’écriture féminine reperées dans la littérature intime et les récits de vie. Après, si les théoriciens littéraires et poétiques inspirés par le "fait littéraire" ont faux, forcément moi aussi. Mais soyons positif et partons de l’hypothèse qu’ils ne disent pas que des conneries, et n'ont pas biaisé leur corpus.
Cet article fait suite à une première analyse des couvertures de Persépolis
1) Persépolis et les théoriciens…
Partons déjà d’un constat : S’il est vrai qu’il n’est jamais évident, voire même pertinent, de traiter de manière théorique l’écriture féminine, dans la pratique, la critique littéraire trouve légitime de réunir dans un même volume des études portant sur des textes aussi différents que la Princesse de Clèves ou Le Ravissement de Lol V. Stein deMarguerite Duras, concluant qu’il existe une parenté que l’on ne trouverait pas dans les écrits d’hommes. Béatrice Didier, plus particulièrement dans ses études Le journal Intime et L’Ecriture-Femme, suggère à plusieurs reprises quatre inclinaisons chez la femme qui semblent admises par la critique littéraire moderne. Attention cependant, il ne s'agit pas de définir une essence de l'écriture féminine, immuable, mais plutot de comprendre si la condition de la femme, qui d'après ces critiques a une forme d'influence reconnaissable sur le processus d'écriture dans une majorité de cas, est visible dans Persépolis.
1.1)L’écriture intime masculine serait volontiers égocentrée tandis que l’écriture intime féminine serait davantage relationnelle. Les femmes se définiraient donc plus facilement à travers le canevas plus large de leurs relations aux autres, et non à travers une recherche introspective et une analyse de soi.
1.2)Les «lignes de forces communes» qui permettent de reconnaître un écrit féminin proviendraient, au moins en partie, d’une certaine situation de la femme dans la société. Une situation fort variable certes, mais particulièrement pertinente dans le cas d’autobiographies célèbres telles que Marguerite Yourcenar, Gisele Pineau, Assia Djébar ou Leila Sébar…
1.3)Néanmoins, l’écriture féminine semble presque toujours le lieu d’un conflit entre le désir violent d’écrire et une société qui manifeste à l’égard de la femme soit une hostilité systématique, soit «une forme atténué, mais plus perfide encore, qu’est l’ironie ou la dépréciation»
1.4)« les femmes aiment à écrire leur enfance» dit-elle, avant de développer que cette qualité leur a été bien souvent reprochée. Et qu’il existe deux obstacles au récit d’enfance encore plus difficiles pour la femme à surmonter : le dégagement d’un intérêt concret pour cette période de l’existence considérée comme futile, plus encore son souvenir ; et le courage d’aborder la découverte de la sexualité, plus particulièrement de sa sexualité et de son éveil.
Je crois sincèrement que l’on peut dire sans effarement que ces quatre caractéristiques de l’écriture féminine sont manifestes dans l’œuvre de Marjane Satrapi. Le récit d’enfance, l’éveil à la sexualité, la position de cette femme dans une société musulmane en voie d’intégrisme… sont autant de thèmes à l’origine de son introspection. Si dans l’autobiographie, l’écrivain homme est confronté avec ce qu’il a à dire ; dans Persépolis, Marjane fait, en plus de cela, face à la transgression religieuse fondamentale qu’est le seul fait d’écrire et de prendre la parole, à l’instar d’auteurs comme Assia Djébar ou Leila Sébar dont les œuvres autobiographiques sont toutes entières dédiées à ce thème.
2) Et le dessin dans tout ça…
Je pense que le dessin est la preuve la plus flamboyante de l’écriture féminine chez Marjane Satrapi (pas de commentaire facile sur féminité et simplicité svp). Ceux qui s’intéressent un tant soit peu aux autobiographies en bande dessinée auront remarqué l’égocentrisme marqué des auteurs, dans cet acharnement des hommes à créer une icône de soi détaillée, reconnaissable, et capable de produire un discours identitaire. Lewis Trondheim ou Art Spiegelman et leur anthropomorphisme ou le réalisme de Neaud… la stylisation est le moteur le plus pratique pour créer un personnage qui ressemble à soi, et qui parle de soi. Il n’y aucune de ces volontés chez Marjane. Sa représentation n’a pas vraiment d’autres sens que la représentation, de montrer qu’elle est là. Tout au contraire, elle exprime violemment le besoin des autres pour se raconter.
Et au lieu de charger de détail son visage afin que le lecteur identifie son personnage, Marjane préfère utiliser la case pour s’extraire de ses camarades voilées. Et ce dès la première page du premier volume, où ce que les critique appellent l’espace inter-iconiques (la bande qui sépare les cases) devient littéralement une ligne de démarcation. Plus loin, les scènes de foule, synthèse des bas reliefs iranien et du graphisme de l’enfance, permettent à son autoreprésentation simpliste d’être parfaitement identifiable tout au long des albums, sans jamais avoir recours à la stylisation égocentrique. Marjane ne se définit graphiquement que « par rapport aux autres ». Une démarche qui rejoint complètement les problématiques de l’écriture féminine comme celle de l’indétermination de l’enfant dans la plupart des récits d’enfance.
Entre spontaneïté et lisibilité des commentaires, pour une fois j'ai choisi la lisibilité. Une démarche généralement contraire au Blog. Mais une trop mauvaise communication entre Ronald et moi avait poluée le débat qui suit, intérressant. Du coup, j'ai coupé certains commentaires. Pas de censure, toutes les parties sont d'accord; les idées sont conservées mais c'est bien plus clair ainsi. J'espères que cela ne pertubera pas trop votre lecture.