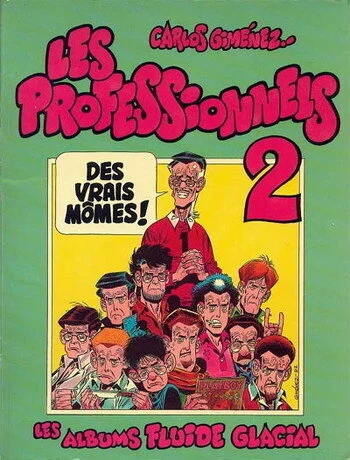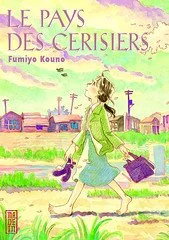Par Stéphane, qui reprend les dépêches AFP comme tout le monde
Ce fil de deux microns supporte en moyenne unemasse d’un gramme, ce qui correspondrait, à plus grande échelle, un filde 1 à 2 millimètres supportant un poids de 65kg.
Si l’araignée reste stable au bout de son fil quoi qu’il arrive, c’est grâce aux étonnantes capacités du fil qu’elle utilise pour tisser sa toile. Souvent associées au dégoût pour le grand public, l’araignée et sa toile présentent des qualités physiques naturelles qu’une équipe de chercheurs du CNRS de Rennes a étudiées,notamment la très grande résistance du fil et ses propriétés de torsion.
Les scientifiques ont voulu comprendre pourquoi une araignée suspendue à un fil arrive à rester parfaitement immobile, au lieu de tourner sur elle-même comme un alpiniste au bout d’une corde.
Ce qui précédait et suit n'est pas une blague, mais bel et bien une découvertes scientifique révélée par le CNRS en début de semaine. Qui à dit qu'on devenait tout les jours un peu plus cons en lisant le aaablog.
PS: Ah oui, vous l'aurez sans doutes remarqué, j'en ai profité pour illustre l'article d'une PHOTO TOTALEMENT INEDITE DE TOBY DANS SON NOUVEAU COSTUME DE SPIDERMAN...
Dans la revue "Nature" publiée jeudi, les chercheurs du laboratoire de physique des lasers détaillent les différentes expériences qu’ils ont menées pour reproduire les propriétés du fil de l’araignée, précise le communiqué du CNRS.
A l’aide d’un pendule de torsion auquel est fixé un fil relié à une masse de poids équivalent à celui d’une araignée, les chercheurs ont comparé les réponses dynamiques de différents types de fils (cuivre, Kevlar, Nitinol) à une rotation de 90 .
Si le filament de Kevlar (matière synthétique) se comporte de manière élastique, avec des oscillations atténuées, un fil de cuivre présente de faibles oscillations mais revient difficilement à sa forme initiale, et en ressort fragilisé.
Quant aux alliages tels que le Nitinol, ils possèdent des propriétés similaires, mais il faut que ce dernier soit chauffé à 90 C pour retrouver sa forme.
Seul le fil de l’araignée possède un haut coefficient d’absorption des oscillations, indépendant de la résistance de l’air,et garde ses propriétés de torsion au fur et à mesure des répétitions.Enfin, il revient complètement à sa position originelle.
Il s’agit d’un matériau dit "à auto-mémoire de forme",c’est-à-dire ne nécessitant aucune aide extérieure pour retrouver sa configuration initiale (ni chaleur ni pression).
Bien que très fin, le fil de l’araignée est "un matériau très résistant, le fil de vie de l’araignée, composé de protéines,d’acides aminés", a expliqué à l’Associated Press Olivier Emile, l’un des trois chercheurs auteurs de l’étude.
Ce fil de deux microns supporte en moyenne une masse d’un gramme, ce qui correspondrait, à plus grande échelle, un fil de 1 à 2 millimètres supportant un poids de 65kg, a-t-il précisé.
Autant de propriétés qui dépassent, selon le CNRS, "celles des fibres synthétiques les plus élaborées".