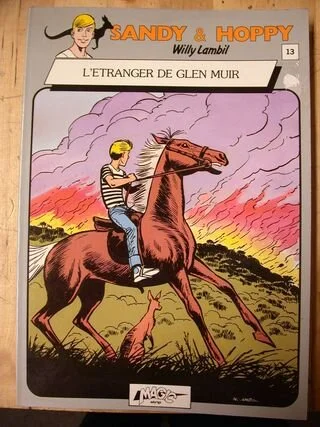Jacques Tardi revient à la peinture des ravages de la guerre. Mais cette fois-ci, il marche sur les traces de son père, soldat enragé par la défaite de 1939 et brisé par 5 ans de détention dans un Stalag. Commence une longue promenade pour un paternel arc-bouté sur sa colère et un enfant déconcerté, le long d’un paysage suspendu dans le temps, jonché de cadavres de chars éventrés et de maisons ébranlées, qui se termine dans les baraquement des camps de détention. Une œuvre personnelle, d’une beauté sidérante et crépusculaire, qui livre enfin certaines des clés de l’œuvre de Jacques Tardi
C’est un projet qui remonte de longue date ?
Enfant, mon père évoquait au quotidien la seconde guerre mondiale et sa détention. Une multitude d’anecdotes impossibles à raccorder. Il m’apparaissait alors, non pas aigri, mais en perpétuelle colère et nos relations en pâtissaient. Au début des années 80, pour remettre un peu d’ordre dans ce passé, je lui ai demandé de consigner sa vie par écrit. Il remplit alors trois cahiers d’écolier. Lorsque les mots ne suffisaient pas, il les complétait de dessins. Je l’ai lu et j’ai su qu’il y avait un récit à en tirer. Mais j’ai laissé ces trois cahiers de coté dans une boite, avec des photos d’époque. Et puis mon père est décédé, en 1986, six ans après. Il y a quatre ans, je les ai repris avec l’idée d’en faire un livre. J’ai fait retranscrire les cahiers à la machine pour qu’ils soient plus lisibles. Pendant ce temps là j’ai réalisé quelques adaptations de Jean-Patrick Manchette, puis je m’y suis remis il y a un an en me disant qu’il était temps pour moi d’en finir avec cette histoire là.
Au début, ce devait faire un volume, mais en définitive il en comptera deux ?
Oui car j’ai envie de poursuivre avec le récit de son retour. Le premier tome s’étend de l’ouverture du conflit en 1939 à l’évacuation des camps, en 1945. Le second volume parlera, lui, du trajet du camp de Czarne, en Pologne, jusqu’à Lille, à l’issue du conflit. C’est un périple de cinq mois jonchés d’embuches dont il ne me reste que le journal de l’époque de mon père. Un journal assez pragmatique, nourri d’éléments factuels dans lequel on ressent surtout l’obsession de la faim. Ce qui m’intéresse, c‘est que mon père, à son retour, reste dans l’armé. Le monde a trop changé en son absence et il n’a pas fait d ‘étude. Il retourne donc en tant que militaire dans l’Allemagne occupée, durant les années 50. Une époque étrange que j’ai connue, avec des bâtiments aux façades éventrées, des baignoires qui pendent aux fenêtres et, en même temps, une économie allemande qui repart plus vite que la française. Mon père s’achète sa première voiture Volkswagen, ma mère un réfrigérateur qu’elle présente à ses voisines françaises à notre retour en France car elles en sont restées aux glacières avec des pains de glace. Ce retour à la prospérité plus rapide de l’Allemagne ulcère mon père.
La guerre, la colère, la révolte contre les institutions… que de thèmes qui nourrissent votre écriture depuis les prémices. Y-a-t-il une volonté de livrer les clés de votre œuvre ?
L’idée ce n’était pas forcément de donner des clés sur mon œuvre. Mais c’est vrai que la guerre empoissait mon enfance et j’aurais préféré qu’on parle d’autre chose. Ce sujet m’a abruti. Je n’ai jamais vu mon père lire autre chose que des livres sur la seconde guerre mondiale. Pareil au cinéma, les films qu’il me montrait me terrorisaient, tel Les diables de Guadalcanal de Nicholas Ray. Ce que je veux faire comprendre, à travers ce livre, c’est cette ambiance dans laquelle j’ai grandi, les mentalités qu’elles ont produites. Un esprit un peu revanchard, patriote qui refusait que ma génération apprenne l’allemand à l’école, ou qui explique que ma belle mère ait toujours eu peur de croiser le soldat qui a tué son mari lorsqu’elle nous rendait visite en Allemagne. Une atmosphère qui entretenait les hargnes et même les haines et qui m’a profondément marqué.
Pourquoi vous êtes-vous représenté enfant, alors que vous n’étiez pas né ?
Vivre avec un type comme ça, d’autant plus quand on est fils unique, n’était pas toujours facile. Vers 17 ans, j’enrageais qu’il soit militaire, je ne comprenais pas et le dialogue était impossible. Du coup, j’ai quitté très tôt le foyer. Ce double ectoplasme, au début du récit, exprime probablement mon désir de créer le dialogue que je n’ai pas eu le temps d’entamer avec lui. Mais ça ne suffit pas. Aujourd’hui, même avec les cahiers, tant de détails me manquent. Par exemple, lorsqu’il me dit que ma mère lui a envoyé de quoi s’évader, comment a-t-elle deviné son projet ? Comment ont-il communiqué ? Je ne peux que conjecturer car je ne lui ai jamais posées ces questions. Tant de réponses me manquent que je le regrette amèrement. Ma mère est vivante mais ne se souvient plus.
Face aux manques, avez-vous comblé ou réinterprété son témoignage ?
Non, je suis resté fidèle. Mon père était précis donc je lui fais totalement confiance quant à l’exactitude. Je réinterprète ses dessins au plus près possible, de même que je replace son expérience personnelle dans un contexte plus large car, dans ses cahiers, il se décrit lui-même dans une espèce de masse, où tout le monde est pris en photo avec un numéro. Je laisse de l’espace aux moments qui l’ont le plus choqué, comme la mort de son ami Chardonnet. Et si le Stalag IIB était réputé pour être une prison particulièrement dure, je ne montre pas les actes violents dont il a été victime, puisqu’il élude le sujet. Il évoque plutôt les russes et les polonais, qu’il dépeint comme les plus malheureux. Il ne centre pas son récit autour de son expérience personnelle, du coup moi-même j’ai replacé cette parole et cette présence au cœur d’un cadre beaucoup plus large.
Repasser par dessus les croquis de son père doit être touchant. D’ailleurs, on sent l’influence de votre père sur votre personnalité.
Quand il voulait expliquer quelque chose et que les mots étaient insuffisants, mon père dessinait toujours. Moi j’ai hérité de ça. Aujourd’hui, je vois la forme de maladresse et de naïveté qu’il y a dans son trait. Mais j’appréciais tellement, quand j’étais gamin, les moments où il dessinait pour moi. Non seulement il était toujours très précis, et son dessin obéissait à une logique. Lorsqu’il crayonnait une locomotive, il commençait par les rails, puis installait les éléments un à un avec logique, puis la dernière chose qu’il ajoutait, c’était la fumée. J’en ai vraiment retenu l’idée que certains mécanismes ne peuvent pas être correctement représentés si l’on ne comprend pas le fonctionnement et l’agencement.
Mais je me rends compte que je n’ai pas hérité que de ça. Ma préoccupation de la précision dans le dessin répond aux années où je l’observait dans son sous-sol recommencer 15 fois les même pièces des mécaniques qu’il fabriquait parce qu’elles n’étaient pas au point. De même que la hargne à l’égard de l’administration m’a été transmise à force de le voir râler parce que les munitions qui arrivaient n’étaient pas compatibles avec les fusils du régiment, ou parce que certains paysans avaient profité de la misère durant la guerre.
Justement, comment s’exprime chez vous cette angoisse de la précision qui vous caractérise ?
J’ai horreur des approximations. Par exemple, les représentations de poilus qui partent au front en 1914 habillés en bleu horizon me font bondir. Ces soldats furent envoyés en pantalon rouge, en plein été, or c’est ce déguisement qui explique les carnages à venir. Je n’aime pas Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick pour ces raisons. Evidemment, le fond prime, mais l’exactitude consolide l’histoire, elle l’explique et la raconte également à sa manière. Ce pantalon rouge en est l’exemple le plus évident, mais il faut savoir que ces soldats portent 20 kilos sur le dos, pour les dessiner courbés. Que leurs chaussures pèsent un poids fou, et qu’ils n’ont pas forcément beaucoup de chaussettes car l’armé Française n’en fournit pas.
Dans Laurence D’Arabie, de David Lean, la documentation est en place et nourrit la mise en scène. Emmanuel Guibert, en bande dessinée, utilise beaucoup de blanc, mais tout ce qu’il dessine est précis. C’est ça que j’aime. Moi, je suis peut-être un extrémiste de l’exactitude. Pour tout dire, il m’est arrivé de sucrer une scène complète d’une aventure d’Adèle Blanc sec car je n’avais pas la documentation nécessaire pour dessiner la porte d’époque du musée Grévin. C’est un peu extrême comme réaction, puisqu’au fond je pouvais contourner le problème sans conséquence pour le récit. Mais c’est quand même ce que j’ai fait.
Supplément en vrac pour mes amis.
J’ai compris à son décès que cette rancœur plongeait ses racines dans sa jeunesse. Il est fait prisonnier à 25 ans, alors qu’il vient de se marier quelques années plus tôt et de s’engager dans l’armée suite aux rumeurs de guerre. Probablement, aussi, pour échapper à un père colérique qui a fait la première guerre mondiale. La vingtaine lui a été volée, et il finit dans un endroit sinistre. Quelques minutes avant sa mort, il parle encore de son char au bord d’un canal, il raconte comment il change d’obus, écrase les soldats allemands. Voilà les évènements les plus intenses de sa vie. Engagé en 1937 suite aux rumeurs de guerre à venir, il fait sa préparation militaire alors qu’il est au collège. L’idée, à l’époque, c’est que l’armée française est invincible. D’où l’insurmontable déception à venir, le plus grands mépris contre les officiers et les gradés, un militaire quasiment antimilitariste. Je n’arrive pas à expliquer qu’il ait rempilé autrement que par manque d’énergie et abattement résultant de 5 ans de captivité. A leur retour, ces prisonniers ont découvert l’existence de la résistance, du marché noir, des déportés. Eux, perdus dans le marasme de ces évènements, donnent l’impression de revenir d’un camp de vacances et n’osent pas ouvrir leur gueule. Tant que possible, ils reprennent simplement leur existence dans le civil.
Et personne n’a vraiment témoigné de leur condition. Ou alors sur le ton de la rigolade. C’est La vache et le prisonnier ou Le colonel Blimp de Billy Wilder. Ne parlons pas de La Grande évasion qui instrumentalise une histoire vraie pour transformer les américains en leaders et en héros. Ceci dit, malgré ce cinéma patriotique, mon père va garder une profonde admiration pour les américains car ils ont continué la guerre. Mes premiers biberons ont été fait avec du lait en poudre qui arrivait directement des Etats-Unis.
Dans le second volume, vous allez pouvoir compléter avec vos souvenirs d’enfance.
Ma scolarisation en Allemagne baignait dans une étrange atmosphère. Un décor de ruines, des rails de tramway tordues, des barbelés partout, des allemands perpétuellement équipés de sacs à dos en cas d’arrivage surprise de patate ou de papier cul. Les enfants jouaient dans les ruines, descendaient dans les mines, les trous, les caves, et un jour, un ami s’est fait arraché un bras par une grenade. Quand il est revenu à l’école, on était tous perturbés. C’est également l’époque des premiers flippers, de la police militaire omniprésente dans les rues, des courses à l’Economa, ce magasin spécialisé pour l’armée. C’est l’atmosphère du Troisième homme de Caroll Reed, les russes qui attaquent sous peu, une jeep américaine qui rentre dans une vitrine car les conducteurs sont ivres, des voitures avec des carrosseries en carton car il n’y a pas assez de métal. Je vais témoigner de ça dans le prochain volume. De notre appartement assez luxueux qu’on partage avec une autre famille de bidasse qui a un enfant comme moi. De ces longues séances où lui et moi arrachons les pages des livres reliés cuir de la bibliothèque du salon pour en faire des avions que l’on jette par dessus le balcon et que le pauvre pharmacien allemand du rez-de-chaussée passe son temps à balayer sans oser broncher- la plupart des allemands faisaient vraiment profil bas. De ce jour où l’on m’a installé dans un char pour faire un tour et de l’immense peur que j’ai ressenti alors, des minutes qui ont suivi à chercher mon père accompagné d’un bidasse avant que je le retrouve sous les combles de la caserne en train de jouer avec un petit train électrique qu’il avait installé, avec un officier.
Ce récit reprend en partie la structure en trois bandes de « C’était la guerre des tranchées ». C’est une forme qui vous sied en quoi ?
Les récits de guerre ne sont pas comme ceux de Manchette, où ça bouge. Je n’ai pas besoin de faire appel à des changements de points de vue, à des champs/contrechamps. D’une manière générale, je ne veux pas y souligner l’action, je préfère montrer les résultats, les destructions du matériel et des hommes plus que les affrontements. Contrairement à la guerre 14 18, pour la seconde guerre mondiale, j’ai très peu de documentation. Quelques photos floues. Et sur le Stalag IIB, à part quelques photos aériennes, on ne trouve pas grand chose. Ce manque de documentation m’a obligé à négocier avec le dessin. Pour l’intérieur des baraquements, heureusement mon père m’avait fait des croquis, et j’avais des photos.
Jacques Tardi et S; ,en exclu partielle .
Vous trouverez rue Dante de quoi vous plonger dans la guerre selon Tardi avec des Tirages de tête du Cri du peuple. Rue Serpente, vous pourriez vous amuser à deviner où aurait du se trouver la scène coupé du musée Grévin grâce à un vieux coffret 7T des aventures d'Adèle Blanc-sec. Dans les deux cas, il faudra attendre encore un peu pour pouvoir feuilleter Moi René Tardi...